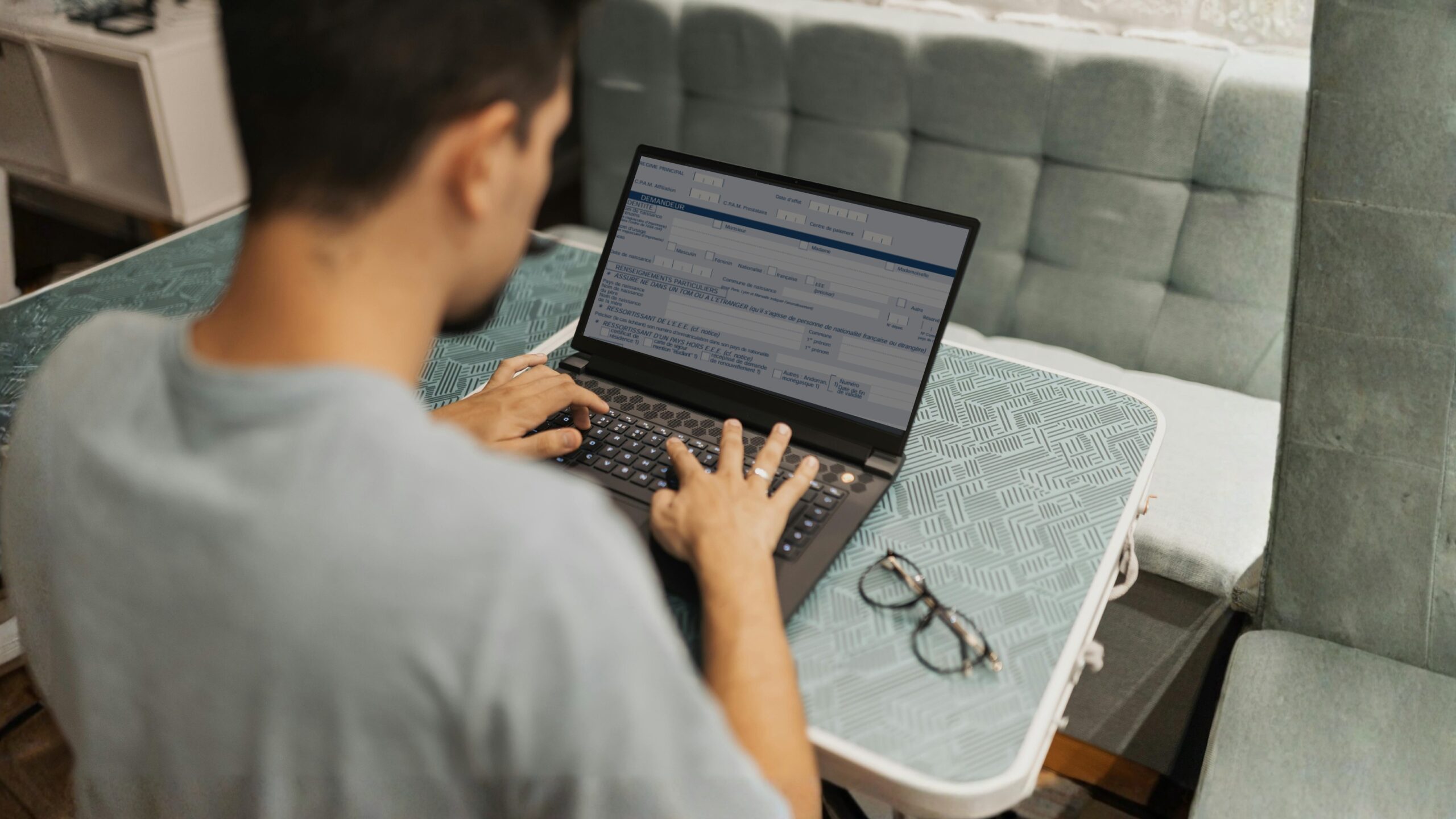Qui n’a jamais soupiré face à un formulaire en ligne ou passé beaucoup de temps au téléphone pour joindre un service public ? Ce sentiment, loin d’être une simple impression, est une réalité chiffrée. Le Défenseur des droits vient de publier son grand rapport d’enquête sur les relations entre les usagers et les services publics, et les résultats sont saisissants. Loin des discours sur la simplification, l’enquête dresse le portrait d’une complexité qui s’étend à toute la société. Voici quelques enseignements surprenants, et parfois contre-intuitifs, de cette étude publiée en octobre.
Le grand paradoxe : plus de difficultés pour moins de « problèmes » déclarés
Le premier grand enseignement du rapport confirme un sentiment public très répandu avec une force choquante : l’impression que les démarches administratives se compliquent n’est pas qu’un ressenti, c’est un raz-de-marée statistique. La part des Français rencontrant des difficultés a explosé, passant de 39 % en 2016 à 61 % en 2024.
Pourtant, et c’est là que réside le paradoxe, la proportion de personnes déclarant avoir rencontré un « problème » spécifique a, elle, diminué, passant de 54 % à 42 %. Comment les difficultés peuvent-elles exploser alors que les problèmes déclarés reculent ? Le rapport suggère une réponse : la dématérialisation simplifie peut-être la résolution de problèmes pour les usagers aguerris, mais pour beaucoup d’autres, elle complexifie l’acte même d’entamer une démarche. Cela suggère que le simple fait de démarrer un processus est devenu le principal obstacle, verrouillant la porte avant même que les citoyens ne puissent savoir s’ils ont un « problème ».
Ce paradoxe pointe vers un coupable central : la transition numérique. Mais les données montrent que ce n’est pas seulement le problème de quelques-uns, c’est un défi pour presque tout le monde.
La dématérialisation pour tous ? Le numérique, c’est compliqué pour (presque) tout le monde
L’idée que le numérique est la solution universelle est sérieusement remise en cause par les chiffres. L’autonomie est loin d’être la norme : moins d’un usager sur deux (49 %) parvient à effectuer seul ses démarches en ligne. 36 % ont besoin d’une aide ponctuelle et 8 % d’un accompagnement systématique.
Surtout, le rapport brise le stéréotype selon lequel seules les personnes âgées ou peu diplômées seraient concernées. Les difficultés numériques se généralisent et touchent désormais les publics que l’on pensait les plus à l’aise. On observe une augmentation spectaculaire des difficultés chez les cadres et professions intermédiaires (+86 %) et chez les diplômés de niveau master et plus (+75 %). Le chiffre le plus étonnant ? Même parmi ceux qui maîtrisent la recherche d’informations en ligne, 38 % rencontrent des difficultés à finaliser leurs démarches. Cela prouve que la maîtrise du numérique n’est pas un bloc monolithique ; savoir naviguer sur Google est une compétence, mais s’orienter dans le labyrinthe des sites officiels en est une tout autre.
« Parler à quelqu’un » : la nouvelle quête du Graal administratif
Si l’on devait résumer la principale source de frustration des Français, elle tiendrait en une phrase : l’impossibilité de parler à un être humain. C’est le problème le plus fréquemment cité, et de très loin. En 2024, 72 % des usagers ayant rencontré un problème mentionnent la difficulté à contacter quelqu’un pour obtenir des informations ou un rendez-vous.
L’ampleur de la hausse est vertigineuse : ce chiffre a presque doublé depuis 2016. Cette « évaporation » du contact humain est la conséquence directe de la dématérialisation à marche forcée, avec la raréfaction des guichets physiques et la saturation des lignes téléphoniques. Cette quête désespérée d’une voix humaine est compréhensible, surtout lorsque les données révèlent une vérité brutale : la solution la plus directe est aussi la plus efficace.
La solution la plus efficace ? Le contact humain, loin devant l’impersonnel
Face à un problème, quelle est la méthode qui fonctionne le mieux ? La réponse du rapport est sans équivoque et va à contre-courant de la tendance au « tout-numérique ». L’enquête révèle que les stratégies reposant sur une interaction humaine directe sont de loin les plus performantes pour débloquer une situation.
Se déplacer physiquement reste la méthode la plus efficace, avec un taux de résolution de 72 %. Juste derrière, le contact téléphonique permet de résoudre le problème dans 67 % des cas. Ces deux approches, qui permettent un échange direct, surpassent nettement les méthodes asynchrones et impersonnelles. Contacter l’administration par Internet ou par mail n’aboutit à une solution que dans 66 % des cas, tandis que le courrier postal est la méthode la moins efficace, avec un taux de réussite de seulement 56 %. Le constat est clair : pour dénouer les situations complexes, rien ne remplace encore un échange personnalisé.
L’abandon des droits : quand la complexité force à renoncer
C’est sans doute le constat le plus grave du rapport : la complexité administrative ne génère pas seulement de la frustration, elle crée du renoncement. Près d’un quart de la population (23 %) a déjà renoncé à faire une démarche pour un droit (prestation, allocation, etc.) auquel elle pouvait prétendre.
La raison principale de cet abandon est la complexité des démarches, citée dans 70 % des cas. Viennent ensuite le manque de temps (34 %) et l’absence de réponse de l’administration (24 %). Mais le rapport met en lumière un facteur encore plus alarmant : le lien entre discrimination et abandon des droits. Les chiffres sont marquants : les personnes ayant vécu des discriminations de la part des services publics renoncent massivement à leurs droits (50 %), contre 20 % pour celles n’en ayant pas vécu. La complexité devient alors une double peine pour les plus vulnérables.
Les recommandations du Défenseur des droits
Au-delà de la problématique de non-recours aux droits qu’une démarche proactive de type « aller vers » peut réduire, ce sont les relations avec les usagers qui permettent de garantir leur égal accès aux services publics. Le Défenseur des droits formule trois recommandations interdépendantes :
Axe
Priorités opérationnelles
Approche omnicanale
Garantir plusieurs modalités d’accès aux services publics en proposant des alternatives à la dématérialisation : accueil au guichet, accueil téléphonique.
Accessibilité
Concevoir des services en ligne universellement accessibles : informations claires et compréhensibles (ergonomie adaptée, langage FALC…), simplification et harmonisation des procédures de demandes de prestations (accessibilité des outils numériques, programme « Dites-le-nous une fois » …), accompagnement des usagers (médiateurs et aidants numériques…).
Droits et recours
Veiller au respect des droits des usagers en matière de transparence, d’avancement des démarches, d’explication des décisions, et d’accès effectif au droit à l’erreur, à la médiation et aux voies de recours.
Le rapport du Défenseur des droits dresse un portrait cohérent et troublant : une approche du « tout-numérique » qui, au lieu de simplifier, a rendu le démarrage des démarches plus difficile pour tous, a supprimé le contact humain pourtant prouvé comme étant le plus efficace pour résoudre les problèmes, et a finalement créé une complexité si écrasante qu’un quart de la population renonce entièrement à ses droits.
Le message est clair : la complexification des démarches administratives n’est plus un phénomène marginal touchant quelques publics fragiles, mais une lame de fond qui affecte toutes les couches de la société. Alors, à l’heure où la France accélère sa transition numérique, comment s’assurer que les services publics de demain ne laisseront pas encore plus de citoyens sur le bord du chemin ?
Pour aller plus loin
Renforcer les compétences qui facilitent les relations avec les usagers et favorisent l’accès aux droits.
Rendre l’accueil opérant – Parcours usager fluide
Interbranche
Interbranche
Branche Maladie
Interbranche
Traiter les situations difficiles sans escalade
Interbranche
Interbranche
Piloter les activités Accueil (référent technique, superviseur, manager)
Branche Maladie
Branche Maladie